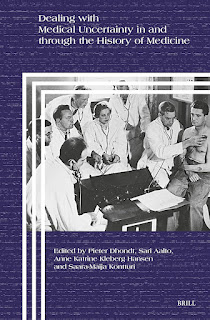Dire l’accouchement
Appel à contributions
Revue Soin, Sens et Santé
L’expérience de l’accouchement est généralement vécue comme un événement majeur, qui mobilise l’ensemble des capacités physiques et émotionnelles. Si le danger de mort, longtemps associé à la parturition, est désormais relativement écarté - en tout cas dans les pays du Nord global - grâce aux progrès de la médecine, l’accouchement reste un moment fort. D’autre part, le fait que l’immense majorité des naissances dans les pays du Nord global se déroule dans un environnement hospitalier a un impact important sur le discours autour de l’accouchement, et sur les mots qui vont être employés pour dire cet événement.
Pourquoi étudier les récits d’accouchement ? Parce que ceux-ci permettent de combler un vide narratif. Du point de vue de la littérature, la plupart des autrices qui décident d’aborder le sujet commencent par s’interroger sur la quasi-absence de scènes d’accouchement dans le canon1, et particulièrement de scènes d’accouchement racontées à la première personne. Des études scientifiques2 ont montré que les femmes qui avaient accouché pouvaient « oublier » les aspects les plus pénibles de leur expérience, et c’est certainement ce qui a été attendu des jeunes mères qui, une fois sorties de l’hôpital, sont le plus souvent renvoyées à l’intimité du foyer et aux travaux du quotidien. La profusion de blogs et autres forums en ligne consacrés aux récits d’accouchement témoigne d’un besoin de raconter cet événement au-delà du cercle familial. Ces récits viennent ainsi pallier une absence majeure de récits réalistes de l’accouchement dans la culture populaire, et viennent servir de source d’information jugée plus authentique que celle qui leur est proposée dans la culture et dans le discours médical.
L’essor d’internet multiplie les espaces plus ou moins anonymes via lesquels les femmes peuvent partager leurs expériences. Cette libération de la parole, via les supports numériques, s’est accompagnée d’une progressive visibilité des questions liées à la maternité dans la littérature, avec la publication grandissante de récits d’accouchement dans les domaines francophone, anglophone et au-delà. Il s’agit ainsi d’analyser comment les femmes relatent leur accouchement, et à quel public elles destinent ces récits. Que veulent dire les femmes qui racontent leur accouchement ? Il s’agit bien souvent de mettre en forme une expérience de l’extrême (douleur, joie) vécue de façon chaotique. Il peut également s’agir de témoigner de sa gratitude, ou au contraire d’exprimer son ressentiment vis-à-vis du monde médical, partie prenante incontournable.
Ce numéro thématique invitera des contributions issues de disciplines variées (telles que la littérature, la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, les humanités médicales, les études de genre), et ancrées dans des approches diverses (décoloniales, critiques, transhistoriques, etc.). Il accueillera aussi des contributions de différents secteurs professionnels de la médecine et du soin, à travers des retours d’expériences par exemple. Elles pourront aborder l’un des axes suivants, ou proposer des réflexions au carrefour de ces trois problématiques :
Expérience vécue et discours scientifique
Pour de nombreuses femmes dans les pays du Nord global, l'expérience du périnatal, du début de leur grossesse jusqu'au suivi de couches, se déroule essentiellement en lien avec le monde médical. Ainsi que l’a fait apparaître la philosophe Camille Froidevaux-Metterie dans son ouvrage Un si gros ventre, la grossesse et l’accouchement supposent l’apprentissage et l’assimilation d’un discours et d’une série de normes qui sont transmises par les professionnels de santé. Le moment de l’accouchement est aujourd’hui un événement autant médical qu’intime, orchestré par des professionnels dont les rôles sont plus ou moins clairement distribués. Des travaux comme ceux de l’historienne Marie-France Morel dans Accompagner l’accouchement d’hier à aujourd’hui. La main ou l’outil ? ont évoqué la manière dont s’est développée la science de l’obstétrique souvent en se substituant au savoir des sages-femmes. Quels ont été les enjeux de la constitution de ce domaine scientifique ? Quelle place est donnée à la parole des femmes dans ce dispositif discursif ?
Contestation du discours médical, approches alternatives de l’accouchement
Dès lors que l’on explore les récits d’accouchement à la première personne, qu’ils soient littéraires ou non, on constate justement qu’ils peuvent fournir un lieu de résistance à ce discours médical, parfois jugé trop intrusif ou déshumanisant. De nombreuses autrices, à commencer par Adrienne Rich, dans son très important Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution, paru en 1976, ont ainsi décrit et dénoncé la surmédicalisation de l’accouchement, notamment dans le contexte nord-américain, où les sages-femmes ont été largement éloignées des salles d’accouchement. Raconter leur accouchement dans leurs mots permet à ces femmes d’articuler leur expérience en dehors de ce discours, et de se le réapproprier. Cela permet également pour certaines femmes de dénoncer les violences obstétricales dont elles ont pu être victimes. Cette prise de parole est dans certains cas encouragée par l’institution médicale, comme en témoignent les ateliers d’écriture organisés par certaines structures hospitalières. Dans cet axe, on peut également s’interroger sur les enjeux de dé-médicalisation de l’accouchement.
Dire l’accouchement à la première personne, que dire et à qui ?
Ces corpus peuvent être constitués à partir de la production littéraire, et notamment parmi les récits de maternité (ou motherhood memoirs) publiés de plus en plus nombreux chaque année. Sont compris dans cette production tous les récits de fiction et de non-fiction, les romans graphiques, etc. qui représentent l’accouchement. On peut également envisager de travailler sur les représentations visuelles de l’accouchement, notamment si elles s’inscrivent dans un projet artistique. Les analyses peuvent aussi prendre leur source dans les espaces en ligne via lesquels les femmes s’échangent librement leurs témoignages : blogs, podcasts, récits postés sur les réseaux sociaux et sur les sites dédiés à la maternité. Les récits provenant de personnes liées aux parturientes (parent, partenaire, ami, etc.) et qui ont participé à l’accouchement, peuvent également constituer un objet d’étude. L’existence d’un tel corpus de textes, on le verra, est essentiel pour faire circuler le savoir, créer des réseaux de solidarité entre femmes, mais également pour visibiliser les luttes des femmes pour qui l’accouchement a été une expérience de discrimination et une source d’inégalité de traitement (sur la base de la race ou de l’identité sexuelle notamment).
La revue Soin, Sens et Santé – An International Journal of the Health Humanities est la première revue française d’humanités médicales et en santé. Elle publie, en français et en anglais, des textes scientifiques de recherche originaux, dans une approche uni ou pluridisciplinaire. Les articles sont évalués selon un processus anonymisé d’évaluation par les pairs.
Les propositions d’article (comprenant un titre et un résumé de 300 mots maximum ainsi que 5 mots clés) sont à envoyer en français ou en anglais avant le 1er juillet 2025 à l’adresse : revue3s@gmail.com
Les auteur.ices seront notifié.e.s de l’acceptation de leur proposition dans un délai d’un mois. Les articles sont attendus pour le 31 octobre 2025.
Les manuscrits des propositions acceptées devront :
- être originaux, ne pas être en cours de soumission pour une autre publication - être écrits en français ou en anglais
- ne pas dépasser 50.000 signes (espaces, notes de bas de page et bibliographie comprises)